ADIEU.
SOIS JUSTE
Les « Testaments »
de José Martí
(1895)
Traduits et annotés
par
Jacques-François Bonaldi
AVANT-PROPOS
Le Centre d’études sur Martí (C.E.M.) de La Havane a publié en 1996, puis en 2004 et en 2011 (en versions révisées et amplifiées de nouvelles notes) une brève « édition critique » intitulée Testamentos de José Martí et contenant six lettres de 1895 distribuées comme suit : à sa mère et à son fils (« Testaments familiaux ») ; au Dominicain Federico Henríquez Carvajal (« Testament antilla-niste ») ; à Gonzalo de Quesada Aróstegui (« Testament littéraire ») ; à María Mantilla y Miyares (« Testament pédagogique ») et à Manuel Mercado (« Testament politique »).
En voici donc la traduction annotée. Quelques courts commentaires sur le contexte. Martí se trouve alors sur l’île Hispaniola, se démenant comme un beau diable (après l’échec par trahison, début janvier 1895, du plan de débarquement grandiose qu’il avait organisé dans le plus grand secret pendant des mois) pour tenter de gagner par un moyen ou un autre Cuba où la seconde guerre d’Indépendance qu’il a préparée depuis 1892 (fondation du Parti révolutionnaire cubain) a éclaté le 24 février après qu’il en a donné l’ordre. On conçoit l’extrême tension dans laquelle il vit ces moments-là. C’est profitant d’un temps d’attente à Montecristi (République dominicaine) qu’il rédige les quatre premières lettres ; il écrit la cinquième à María Mantilla à Cap-Haïtien (Haïti) où, accompagné de Máximo Gómez et quatre autres compagnons, il reste caché pendant trois jours chez son ami Ulpiano Dellundé ; la dernière est datée de Cuba, la veille de sa mort à Dos Ríos.
{C}
{C}{C}{C}
À MANUEL MERCADO
Campement de Dos Ríos [Cuba], le 18 mai 1895[1]
Monsieur Manuel Mercado
Mon frère très cher, je peux désormais écrire. Je peux désormais vous dire avec quelle tendresse et quelle reconnaissance et quel respect je vous aime, vous et ce foyer qui est mien et qui mon orgueil et mon obligation. Je cours désormais tous les jours le risque de donner ma vie pour mon pays et pour mon devoir – puisque c'est ainsi que je le comprends et que j'ai assez de forces pour l'accomplir – qui est d'empêcher à temps, par l'indépendance de Cuba, que les Etats-Unis ne s'étendent dans les Antilles et ne retombent, avec cette force de plus, sur nos terres d'Amérique. Tout ce que j'ai fait à ce jour et tout ce que je ferai, c'est pour cela. Il m'a fallu le faire en silence et, disons, indirectement, car, pour pouvoir les réaliser, certaines choses doivent être occultes et si on les proclamait pour ce qu'elles sont, elles soulèveraient de trop rudes difficultés pour atteindre malgré tout le but. Les obligations mineures et publiques des peuples – comme le vôtre, qui est aussi le mien – dont l'intérêt le plus vital est d'empêcher que ne s'ouvre à Cuba, par l'annexion des impérialistes[2] de là-bas et des Espagnols, la voie, qu'il faut obstruer et que nous obstruons par notre sang, de l'annexion des peuples de notre Amérique au Nord convulsé et brutal qui les méprise, les eussent empêchés d'adhérer ostensiblement et d'aider ouvertement à ce sacrifice, qui se fait pour le bien immédiat et leur propre bien[3]. J'ai vécu dans le monstre et j'en connais les entrailles. Et ma fronde est celle de David[4]. A l'instant même, car cela fait des jours, au lendemain de la victoire par laquelle les Cubains ont salué notre sortie en liberté des sierras où nous, les six hommes de l'expédition[5], nous avons déambulé quatorze jours durant[6], le correspondant du Herald[7], qui m'a tiré de mon hamac et de mon abri, me parle de l'activité des annexionnistes, moins redoutable du fait du peu de réalité des aspirants, de l'espèce courtisane, sans ceinture ni création qui, pour déguiser commodément leur complaisance ou leur soumission à l'Espagne, lui demandent sans foi l'autonomie de Cuba, juste contents de ce qu'il y ait un maître, Yankee ou Espagnol, qui les maintienne ou leur crée, en récompense de leur office d'entremetteuses, la position de notables, dédaigneux de la masse robuste, de la masse métisse, habile et émouvante, du pays, de la masse intelligente et créatrice de Blancs et de Noirs. Et il me parle d'autre chose, le correspondant du Herald, Eugene Bryson : d'un consortium yankee – qui ne sera pas – comptant sur la garantie des douanes, trop endettées auprès des banques espagnoles rapaces pour qu'il en reste quelque chose pour celles du Nord, d'autant que celui-ci est incapable heureusement, de par sa constitution politique entravée et complexe, de lancer ou de soutenir l'idée comme oeuvre du gouvernement. Et il m'a parlé[8] encore d'autre chose, Bryson – bien que la véracité de la conversation qu'il m'a rapportée, seul celui qui connaît de près le brio avec lequel nous avons soulevé la révolution puisse la comprendre – à savoir du désordre, du dégoût et de la mauvaise solde de l'armée novice espagnole, et de l'incapacité de l'Espagne de lever à Cuba ou ailleurs les ressources contre la guerre qu'elle avait, la fois antérieure, tirées uniquement de Cuba. Bryson m'a raconté sa conversation avec Martínez Campos[9], à la fin de laquelle celui-ci a laissé entendre qu'une fois l'heure venue, l'Espagne préférerait sans doute s'entendre avec les Etats-Unis plutôt que de faire reddition de l'île aux Cubains. Et il m'a dit encore plus, Bryson : d'une de nos connaissances et du fait qu'on veille sur elle au Nord, comme le candidat des Etats-Unis, quand le président actuel aura disparu, à la présidence du Mexique[10]. Ici, je fais mon devoir. La guerre de Cuba, – réalité supérieure aux vœux pieux et dispersés des Cubains et Espagnols annexionnistes auxquels seule leur alliance avec le gouvernement espagnol donnerait un pouvoir relatif, – est venue à son heure en Amérique pour éviter, même contre l'emploi déclaré de toutes ces forces-là, l'annexion de Cuba aux Etats-Unis qui ne l'accepteront jamais d'un pays en guerre et qui ne peuvent contracter, car la guerre n'acceptera pas l'annexion, l'engagement odieux et absurde d'abattre pour leur compte et par leurs armes une guerre d'indépendance américaine. Et le Mexique, ne trouvera-t-il pas une façon judicieuse, efficace et immédiate, d'aider à temps celui qui le défend ? Oui, il la trouvera, ou je la lui trouverai, moi. C'est une question de vie ou de mort, et on ne saurait se tromper. La façon discrète est la seule qui doive se voir. Moi, je l'eusse déjà trouvée et proposée. Mais, pour cela, je dois avoir plus d'autorité en moi, ou savoir qui l'a, avant d’œuvrer ou de conseiller[11]. Je viens d'arriver. La constitution de notre gouvernement, utile et simple, peut prendre encore deux mois, s'il doit être réel et stable. Notre âme ne fait qu'une, et je la connais, ainsi que la volonté du pays, mais ces choses-là sont toujours une question de relations, de moments et d'accommodements. Fort de la représentation que je détiens, je ne veux rien faire qui en paraisse une extension capricieuse. Je suis arrivé, avec le général Máximo Gómez et quatre autres, sur une barque où j'ai tenu l’aviron de proue sous l'averse, à une pierraille inconnue de nos plages; j'ai porté pendant quatorze jours, à pied à travers des épines et des hauteurs, mon havresac et mon fusil – nous avons soulevé des gens à notre passage. C'est dans la bienveillance des âmes que je découvre la racine de mon affection envers la souffrance de l'homme et envers la justice d'y remédier; les campagnes sont nôtres sans conteste, au point qu'en un mois, je n'ai pu entendre qu'un coup de feu. Et, aux portes des villes, soit nous remportons une victoire soit nous passons en revue, dans un enthousiasme pareil à la flamme religieuse, trois mille armes; nous poursuivons notre chemin vers le centre de l'île, moi pour déposer devant la Révolution que j'ai fait se lever l'autorité que l'émigration m'a donnée et qui a été respectée ici dedans et qu'une assemblée de délégués du peuple cubain visible, des révolutionnaires en armes, doit renouveler conformément à son nouvel état. La révolution souhaite la pleine liberté de l'armée, sans les entraves qu'une Chambre sans sanction réelle, ou la suspicion d'une jeunesse jalouse de son républicanisme, ou les jalousies et les craintes d'une prééminence excessive à l'avenir d'un caudillo tatillon ou prévoyant lui avaient opposées auparavant[12]; mais elle veut une représentation républicaine à la fois succincte et respectable, la même âme d'humanité et de dignité, pleine d'aspiration à la dignité individuelle, que celle qui pousse les révolutionnaires à la guerre et les y maintient. Pour ma part, je comprends qu'on ne peut guider un peuple contre l'âme qui le meut, ou sans elle, et je sais comment s'enflamment les cœurs, et comment on tire profit, en vue du tourbillon incessant et de l'assaut, de l'état fougueux et satisfait des cœurs. Mais, en ce qui concerne les formes, bien des idées ont leur place. Les choses d'hommes, ce sont les hommes qui les font. Vous me connaissez. En moi, je ne défendrai que ce que j'estime comme garantie ou service de la révolution. Je sais disparaître. Mais ma pensée ne disparaîtrait pas, et mon obscurité ne m'aigrirait pas. Et dès que nous aurons une forme, nous agirons, que cela m'incombe à moi, ou à d'autres.
Et maintenant, ayant fait passer en premier l'intérêt public, je vous parlerai de moi, car seule l'émotion de ce devoir a pu soustraire à la mort convoitée l'homme qui, maintenant que Nájera ne vit plus où on le voit[13], vous connaît le mieux et caresse en son cœur comme un trésor l'amitié dont vous l'enorgueillissez. Je connais vos reproches, muets, depuis mon voyage[14]. Et dire que nous lui avons tant donné, de toute notre âme, et il reste muet ! Quelle tromperie que celle-ci et quelle âme endurcie que la sienne, au point que le tribut et l'hommage de notre affection n'ont pu lui faire écrire une lettre de plus sur le papier à lettre et le papier-journal qu'il noircit chaque jour !
Il est des affections d'une pudeur si délicate...[15]
[1] Cette dernière lettre à Mercado – interrompue par l'arrivée au camp des insurgés du général Bartolomé Masó et inachevée, comme on le verra, puisque Martí est tué le lendemain dans une escarmouche avec les forces espagnoles – constitue l'avant-dernier écrit de Martí dont le dernier est un court message, du 19 mai, au général Máximo Gómez. La lettre à Mercado que Martí portait sur lui à sa mort (avec d’autres qui lui étaient adressées, entre autres par Carmen Miyares et ses deux filles María et Carmen Mantilla), fut récupérée par le colonel Ximénez de Sandoval, chef du convoi que Máximo Gómez était parti attaquer, qui les fit parvenir ensuite au général Salcedo, son supérieur dans cette région militaire. Le manuscrit arriva finalement en des mains cubaines et fut publié dans la revue havanaise El Fígaro en 1909.
[2] Il est on ne peut plus symptomatique que ce mot – absent de toute la vie publique de Martí – apparaisse dans cette lettre intime à l'un de ses plus vieux confidents épistolaires où il révèle le fond et le fondement de sa pensée politique, maintenant que la bataille sur le terrain militaire est engagée pour de bon ! Précisons toutefois que le terme n'a pas sous la plume de Martí la connotation que Lénine lui donnera quelques années plus tard ; mais il vaut peut-être la peine de rappeler que le dirigeant bolchevique considéra la guerre qu'avait lancée Martí, dès lors que les États-Unis y intervinrent en 1898 (prenant le nom de guerre hispano-américaine dans l'historiographie officielle, comme si les Cubains avaient fait tapisserie!) comme la première guerre impérialiste de l'ère moderne.
[3] La lecture des Œuvres complètes donnait à ce jour « en bien inmediato y de ellos », leçon que le CEM reprend dans son recueil des lettres à Mercado (José Martí, Correspondencia a Manuel Mercado, La Havane, 2003, Centro de Estudios Martianos, p. 337). Epistolario (t. V, p. 250) livre, soit par erreur de lecture de García Pascual et Moreno Pla qui ont colligé une photocopie du manuscrit original, soit par simple coquille d’imprimerie : « en bien inmediato de ellos », ce qui modifie sur le fond la pensée de Martí dans la mesure où, curieusement, l'indépendance de Cuba (le bien immédiat) disparaît pour ne laisser place qu'à la protection des peuples latino-américains contre les visées nord-américaines (el bien de ellos). On retrouve cette même erreur dans la traduction de Joucla-Ruau (« au bénéfice immédiat de ces peuples eux-mêmes », op. cit., p. 148), qui redouble la confusion en traduisant, deux lignes plus haut, un hypothétique habrían (auraient ou eussent) par un catégorique : « avaient »... Signalons une autre grave coquille in Epistolario (p. 251) : blancos (Blancs) au lieu de bancos (banques).
[4] Nous sommes en présence dans ce premier paragraphe – que la plupart des Cubains peuvent réciter par cœur – d'un texte en quelque sorte fondateur de la Révolution cubaine, que l'Histoire du dernier siècle vient corroborer : pour des raisons tout à la fois historiques et géographiques, l'indépendance de Cuba – dont la véritable garant est le processus enclenché le 1er janvier 1959 – ne peut se faire que face aux États-Unis et contre eux, tant que ceux-ci estimeront – comme l'histoire de l'Amérique latine le prouve abondamment – que la « destinée manifeste » leur a octroyé un droit de tutelle sur le reste du continent, à plus forte raison sur cette île que, dès l'époque de Jefferson, ils considéraient leur à compter du jour où l'Espagne ne serait plus en mesure de la dominer (théorie du « fruit mûr »). La politique obsessionnelle et maladivement insane de dix administrations nord-américaines contre la Révolution cubaine, depuis maintenant plus de cinquante ans, prouve combien douloureusement l'infraction à cette règle sacro-sainte a été ressentie par les États-Unis et combien le camouflet a été cinglant.
[5] Les six hommes qui ont débarqué le 11 avril 1895, vers dix heures et demie du soir, à La Playita, sur la côte sud, entre Maisí et Guantánamo, en provenance de Cap-Haïtien, sont José Martí, Máximo Gómez, Francisco Borrero, Angel Guerra, César Salas et Marcos del Rosario.
[6] Martí se réfère au combat d'Arroyo Hondo que livrent, le 25 avril 1895, les forces cubaines aux ordres de Periquito Pérez et de José Maceo contre les troupes espagnoles du colonel Copello, embusquées sur le pont qui franchit le cours d'eau dans l'attente du passage de Gómez et Martí. Les six hommes ont, durant ces quatorze jours, marché environ cent soixante kilomètres en pleine montagne. (Ces renseignements précis sont tirés de José Martí, Diarios de campaña, op. cit.)
[7] Martí écrit dans son journal le 2 mai 1895 : « Nous sommes arrivés à Leonor, et, éludant le repas tardif, nous étions allés nous coucher avec du fromage et du pain, quand le correspondant du Herald, George Eugene Bryson, arrive avec la cavalerie de Zefí. Je reste avec lui jusqu'à trois heures du matin. » Le 3 : « Je travaille la journée entière au manifeste pour le Herald, et encore autre chose pour Bryson. » Celui-ci repart le 4 mai. Le journal est le New York Herald*, l'un des plus importants de l'époque, qui avait interviewé Martí en 1893. Celui-ci en profite pour rédiger (datée du 2 mai) une lettre-manifeste au directeur du journal new-yorkais où il explique « succinctement au peuple des États-Unis et au monde les raisons, la composition et les objectifs de la Révolution que Cuba a lancée depuis le début du siècle, qui s'est maintenue en armes avec un héroïsme reconnu de 1868 à 1878 et qui reprend aujourd'hui grâce aux efforts ordonnés des enfants de ce pays, à l'intérieur et à l'extérieur de l'île, afin de fonder, fort du courage expert et du caractère mûr du Cubain, un peuple indépendant, digne et capable de mettre en place le gouvernement à lui qui ouvrira la richesse stagnante de l'île de Cuba, – dans la paix qui seule peut assurer la dignité satisfaite de l'homme -, au travail libre de ses habitants et au passage franc de l'Univers. » Et pour lui donner plus de poids, Martí la fait signer par le général en chef Máximo Gómez. The New York Herald en publie, le 19 mai 1895 (le jour même de la mort de Martí !), une version anglaise fortement sollicitée qui enlève une bonne partie de leur mordant (voire les supprime purement et simplement) aux passages où Martí avertit au sujet du danger que représentent les États-Unis pour la Révolution cubaine et l'indépendance de l'Amérique latine. (Sur cette question, cf. l'analyse comparée que fait Luis Toledo Sande, « José Martí contra The New York Herald. The New York Herald contra José Martí », Anuario del Centro de Estudios Martianos, nº 10, 1987, pp. 21-72. Le texte intégral sera publié in Patria, le 3 juin 1895. On trouvera les trois textes in Epistolario, t. V, pp. 205-225.) Luis Toledo Sande estime à juste titre que cette lettre au journal new-yorkais et la lettre à Mercado s'éclairent mutuellement.
*The New York Morning Herald, qui fut durant de nombreuses années le rival du New York Sun, vit le jour le 6 mai 1835 comme journal de quatre pages à quatre colonnes, et vendu un centime par son rédacteur en chef et concepteur James Gordon Bennett I, qui annonça dans un éditorial son intention de publier un journal indépendant pour les masses. A la mort du fondateur (1872), c’est son fils de vingt et un ans qui prit la relève, se frayant une carrière spectaculaire dans le journalisme. Il mit en place un service de correspondants étrangers étendu au monde entier, l’emportant en vitesse sur ses rivaux moins entreprenants. Ainsi, de 1874 à 1877, Henry M. Stanley chercha Livingstone en Afrique pour le journal qui publia des centaines de colonnes sur cette expédition qui lui coûta une fortune. En 1879, il équipa l’expédition polaire de La Jeannette. En 1883, il créa avec John W. Mackey la Mackey-Bennett Cable Company qui lui permit de dicter les politiques du journal par câble. Il fonda une édition londonienne qui échoua et une édition parisienne qui réussit et qui fut dans les dernières années de la Première Guerre mondiale le seul journal publié à Paris, les autres ayant déménagé à Bordeaux. Passionné de sport, il fit suivre des régates transatlantiques par radio. À sa mort en janvier 1917, le Herald était lourdement endetté. Frank A. Munsey l’acheta pour un million de dollars en effectif et trois millions en effets. Sous la direction de Munsey, le journal continua à perdre de son prestige et de son importance jusqu'à sa vente au Tribune. (D’après The History of New York State, Book XII, Chapter 21, “The New York press and its editors”, Editor, Dr. James Sullivan,
[8] Je m'en tiens – par respect pour cette lettre inachevée et les conditions dans lesquelles elle a été écrite – à sa leçon originale, mais il est évident que Martí l'aurait retouchée s'il avait eu le loisir de le faire : il commence en effet par deux verbes au présent («il me parle») et poursuit à partir d'ici par trois passés simples de ce même verbe. Et le début de la phrase prête encore plus à confusion : cet « à l'instant même » contredit le « voilà quelques jours », d'autant que Martí évoque aussitôt une bataille ayant eu lieu le 25 avril, soit presque un mois avant ! On sait par ailleurs que Bryson est reparti le 4 mai. Martí ne peut donc parler que d'une conversation passée, même si tout le début donne l'impression qu'il se réfère à quelque chose qui se passe au même moment.
[9] Arsenio Martínez Campos (1831-1900), le général qui avait conclu la guerre de Dix Ans sur un pacte du Zanjón controversé, et que nous retrouvons face à cette nouvelle guerre d'Indépendance cubaine en tant que capitaine général de l'île. Mais il échouera cette fois-ci et devra se retirer. Son successeur, Valeriano Weyler, enfermera les paysans dans des camps de concentration aux abords des villes pour « enlever l'eau aux poissons » et provoquera une terrible hécatombe, qui empirera quand les États-Unis, intervenant dans la guerre en 1898, instaureront un blocus naval de l'île.
[10] On ignore à ce jour de qui il s'agit ? Peut-être de Romero Rubio, selon Pedro Pablo Rodríguez, qui n'en mettrait pas pour autant la main au feu...
[11] Martí tient, maintenant la guerre vraiment lancée, à faire reconnaître sur le terrain, aussi bien par les civils que par les militaires, la fonction qu'il occupe de délégué du Parti révolutionnaire cubain et à créer une structure politico-militaire qui permette de diriger la guerre avec l'appui de tous.
[12] Ce sont là des allusions à des faits survenus pendant la guerre de Dix Ans (1868-1878), qui l'avaient justement empêchée de se développer et d'atteindre la victoire finale.
[13] Manuel Gutiérrez Nájera est mort en effet le 3 février. On ne connaît qu'une seule lettre de lui à Martí, du 15 décembre 1890 : « Mon cher ami : J'ai besoin de vous écrire pour solder mes dettes avec l'année qui s'en va et ouvrir mon compte courant pour celle qui vient. Il me semble que vous m'écrivez quand je reçois l'une de ces correspondances qui apportent du soleil au Partido Liberal : je suis le premier à les ouvrir; le premier à les savourer; et le premier à gronder les typographes pour le traitement sacrilège qu'ils vous infligent. Je me considère votre débiteur de bien des gouttes de lumière, de bien des diamants, de bien des bouquets de fleurs, et, – qui plus est – de bien des idées qui ennoblissent mon esprit et qui me réconcilient avec les idéaux fugaces. Ici, c'est jour de fête quand vos correspondances arrivent, et mon affection, comme un bambin turbulent qui attend des friandises et des jouets, court à leur rencontre les recevoir. Voilà pourquoi j'ai pensé vous écrire cent fois très longuement : je sens que j'ai un ami, que je connais à peine, à un endroit que je ne connais pas. Et si je n'ai pas écrit, c'est qu'à force de noircir du papier, j'ai pris mon encre en haine, mais non celle d'autrui. / Aujourd'hui, mon ami, force m'est pourtant que mes lettres se rendent chez vous, tout comme les pauvres se rendent chez les riches pour leur demander l'étrenne. J'ai à ma charge El Partido Liberal, à causes des occupations pressantes de son directeur, et comme l'année nouvelle va commencer et que nous voulons que cette publication s'améliore un tantinet, il est bon de demander aux sommités de l'intelligence comme vous de continuer de la protéger. Je vous écrirai souvent pour vous communiquer mes projets et vous demander conseil... » (Destinatario José Martí, op. cit., pp. 191-192.) Martí a dû éprouver douloureusement cette perte si l’on en croit la dédicace qu’il lui avait écrite sur un exemplaire de Versos Sencillos : « Ivoire dans le vers, dans la prose soie, dans l’âme or. »
[14] À l'été 1894, Martí entreprend un voyage à Mexico dans trois objectifs : renouer les contacts avec ses amis personnels et les Cubains pour les informer de la marche des préparatifs et collecter de nouveaux fonds; contrecarrer la forte influence des Espagnols ; enfin, rencontrer le président Porfirio Díaz pour obtenir de lui un engagement de soutien matériel (armes et équipements) quand la guerre aurait éclaté. Il arrive le 18 juillet en provenance de la Nouvelle-Orléans et de San Antonio (Texas), s'installe à l'hôtel où il tombe malade, se loge ensuite chez Manuel Mercado le 22, part le 25 pour Veracruz, rentre dans la capitale deux jours plus tard. Entre temps, Porfirio Díaz lui a concédé un entretien pour la veille. Martí lui demande alors un nouvel entretien qui semble bien avoir eu lieu le 1er août 1894. Il écrit le 23 juillet 1894 au président : « Un Cubain prudent, investi de la représentation de ses concitoyens... qui ne voit pas dans l'émancipation de Cuba la simple émancipation politique de l'île, mais rien moins que la préservation de la sécurité et de l'indépendance de tous les peuples hispano-américains, en particulier de ceux de la partie nord du [sous-]continent, est venu... expliquer en personne... la signification et la portée de la révolution sacrée d'indépendance, et ordonnée et prévoyante, à laquelle se dispose Cuba. Les Cubains ne la font pas seulement pour Cuba, mais pour l'Amérique; [Les Mexicains ne sauraient considérer comme des étrangers] ceux qui, aux portes de leur patrie, au carrefour futur et proche du monde, et face à une nation étrangère et ambitieuse, vont se battre pour la dignité et le bien-être de leurs compatriotes et pour l'équilibre et la sécurité de notre Amérique. Il s'agit, pour les Cubains indépendants, d'empêcher que l'île corrompue aux mains de la nation dont le Mexique a dû aussi se séparer ne tombe pour son malheur et au grand dam des peuples d'origine espagnole en Amérique sous une domination funeste aux peuples américains. L'entrée de Cuba dans une république opposée et hostile [les USA] – ce qui sera fatalement sa fin si l'indépendance aujourd'hui possible et opportune est ajournée – menacerait, voire liquiderait, l'indépendance des républiques hispano-américaines dont elle semble le gardien et dont elle fait partie du fait du danger commun, des intérêts et de la nature même. » (« Martí en México. Nuevos documentos », in Anuario del Centro de Estudios Martianos, nº 14, 1991, pp. 13-14. Sur ce séjour de Martí au Mexique, cf. Alfonso Herrera Franyutti, Martí en México. Recuerdo de un época, Mexico, 1969, s. éd., pp. 111-131 et 139.) Martí rentre à New York autour du 10 août 1894. Cette démarche de Martí à Mexico explique les deux télégrammes de janvier 1895.
[15] L’arrivée au campement du général Bartolomé Masó et de sa troupe contraint Martí, je l’ai dit, à interrompre sa lettre. Ce sont les derniers mots qu’il écrivit, hormis une courte missive adressée au général Máximo Gómez le lendemain, à peine quelques heures avant de tomber au cours d’une charge contre des Espagnols : « Général, nous sommes partis vers quatre heures pour arriver à temps à La Vuelta où les forces de Masó sont passées à partir de dix heures pour camper et rétablir leur cavalerie très fatiguée. Elles sont arrivées hier soir. Je ne serai pas tranquille tant que je ne vous aurai pas vu revenir. Je veille sur votre havresac. Les forces, bien que sans animaux utiles, auraient voulu partir vous suivre à la recherche du convoi [un convoi espagnol que Gómez tente de détecter pour l’attaquer], mais elles redoutaient de se perdre en allées et venues au lieu de vous être utiles. Le voyage inutile à la Sabana a beaucoup fâché Maso. Votre J. Martí. » (Epistolario, op. cit., t. V, p. 253.)

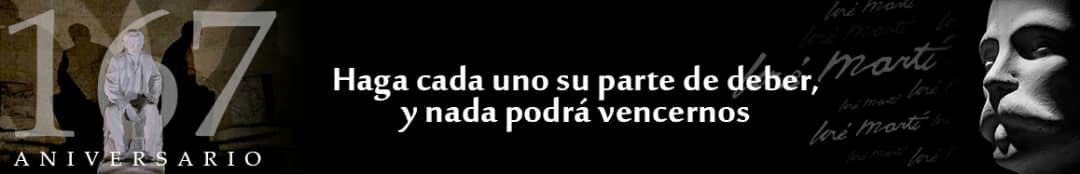



Deje un comentario